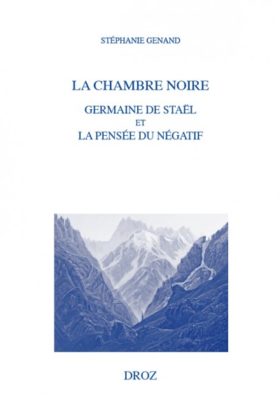À qui voudrait réduire l’œuvre de Germaine de Staël au mythe de la femme exaltée, La Chambre noire oppose désormais un solide démenti. L’ouvrage de 384 pages, issu de l’Habilitation à diriger des recherches soutenue par Stéphanie Genand en novembre 2014, s’ouvre sur l’éclairage d’un « malentendu » (9) – celui d’une femme traditionnellement présentée comme « le stéréotype du trop » (21) – et confronte à cette allégorie de l’excès un portrait symétriquement opposé. Soulignant les écueils de cette postérité aveuglante, Stéphanie Genand se concentre sur les seuils moins connus de l’auto-analyse et interroge l’hypothèse d’un versant négatif de l’œuvre. Elle cherche ainsi dans les creux de l’écriture matière à retracer « l’épreuve du vide » (27) qui préparerait pour Staël la refonte progressive de son identité. En poussant la porte de la chambre noire, l’auteur nous invite donc à explorer un espace staëlien inédit, l’« antichambre » (30) qui renfermerait ses méditations. Lieu de médiation, la chambre noire est aussi présentée comme la « scène parallèle » (29) sur laquelle se jouerait la confrontation courageuse du « sujet neutre » (23) avec ses propres carences : tout individu ne se construit-il pas en partie sur un déficit, une absence, une privation ou un oubli ? L’ouvrage convertit cette intuition originelle selon laquelle « quelque chose manque » (21) – phénomène transversal que l’essai se propose d’élucider – en une stratégie de réhabilitation fondée sur la relecture de l’œuvre par le prisme du négatif. L’interrogation liminaire – « Comment l’œuvre staëlienne rencontre-t-elle l’inconscient ? » (31) – l’inscrit dans la lignée de l’École de Genève et notamment des travaux de Jean Starobinski, qui a fait de la mélancolie une notion-clé de l’œuvre, révélant Staël en « clinicienne » (22). S. Genand lui emprunte aussi son approche transgénérique et l’abolition d’une frontière entre la vie et l’œuvre pour fédérer l’ensemble des textes autour d’une même ambition : « écouter G. de Staël » (35). Auto-qualifié de « récit » (33) et de « traversée » (35), l’essai s’annonce comme un parcours chronologique et surtout anthropologique, divisé en trois parties qui sont autant d’étapes vers une réconciliation du sujet staëlien.
D’abord portée par la volonté de « rendre à Staël la force de sa parole » (35), S. Genand nous projette sur les lieux d’une « venue au monde » (42) ; le salon, où retracer l’itinéraire de l’oratrice-née, devenue l’auteur que l’on connaît. Mais que coûte la conversion du « plaisir de dire en art d’écrire » (58) ? Et comment gagner le « droit à l’œuvre » (61) ? Telle est la trame de cette première partie. Si le portrait d’une Louise volubile immortalise l’image de l’enfant prodige et articule l’œuvre autour d’une « empreinte vocale » (49) dont les premiers éloges contiendraient la trace sonore, Paraître et disparaître sonne le glas de l’enfance heureuse au carrefour de l’année 1786, par « l’acquisition d’un savoir qui ne coûte pas la vie, mais l’innocence » (91). Surgit alors une « défiance envers les mots » (79), présentée comme la caractéristique des œuvres de jeunesse parcourues d’héroïnes aphasiques et de folles que l’on fait taire, toutes condamnées par leurs discours ou leurs silences. Voilà qui justifie l’avènement d’un « système linguistique hiérarchisé » (88) : Soi-même comme une autre relate la reconquête du « langage archaïque » (73), cette communication primitive de l’enfance, qui apparaît ici comme une ressource face au péril de l’incommunicabilité. Où trouver une telle « parole des profondeurs » (93) sinon en soi ? Autre recours selon S. Genand que le modèle rousseauiste qui plane sur cette période d’insurrection, au moment où l’écriture, de conventionnelle, deviendrait « dynamique, ponctuée d’interjections, d’interrogations, d’apostrophes » (130) et inspirerait à Staël un attrait pour cette « langue de l’âme » (141) qu’elle lui emprunte. Partitions révèle donc la brutalité d’un transfert au cours duquel les partitions de musique et l’élan poétique qu’elles inspirent – à la fois réfréné par la mère et encouragé par le père – aboutissent aux douloureuses partitions de l’être, qui l’entrainent, d’abord amèrement, puis avec passion, sur les chemins méditatifs. Ne subsistent alors que les vestiges d’une « spontanéité condamnée à la médiation » (80) et au séquençage (160), lorsque Staël se voit contrainte de se dédoubler pour penser un univers lui-même fragmenté.
Dans le sillage de Catherine Dubeau qui s’intéressait à la relation de Suzanne avec sa fille, La Chambre noire réintègre, au cœur des protocoles d’écriture, l’autre problématique, des figures tutélaires à la horde menaçante. Peut-on à la fois être soi et « réussir les héritages » (14) ? L’arbre et le fruit développe – après la révélation d’une « altérité narrative » (80) dans les œuvres de jeunesse – le choix des expériences qui offrent au sujet l’opportunité de voir l’autre sans truchement. L’exemple des Lettres sur Rousseau, perçu comme une « épreuve de la différence » (122) du fait de la confrontation au négatif du père révèle ici, en parallèle de l’admiration passionnée, une retenue face aux forfaits de l’homme qui laissera place, dans de De l’Influence des passions à des réflexions universelles sur la passion du crime. Vivre sa propre « neutralisation » (178) engendrait donc un esseulement provisoire : l’image de la « descente » (186) souligne ici l’abnégation d’une femme, qui, à l’âge de 25 ans, accepte les conséquences irrémédiables de ce retour sur soi. Ainsi s’impose, au chapitre Donner au jour les rêves de la nuit, la question d’une écriture de l’intériorité : « D’où vient le singulier investissement de la fiction » (234) sinon d’une rencontre de Staël avec sa « part incontrôlée » (227) ? Contrevenant au mythe de la romancière-née en parlant de pratique « rétive » (247), S. Genand questionne le sens de cette carrière tardive en s’appuyant sur les études génétiques consacrées à Delphine. Elle trouve alors dans les rêves le lieu de « fabrique des fictions » (235) et relance la polémique morale liée aux écrits d’imagination : comment justifier l’échec de la vertu ? S. Genand attire alors notre attention sur l’inconscient d’une œuvre marquée par l’impuissance de la langue qui ne permet plus que l’« expression implicite de la douleur » (266). Médiations présente donc l’analyse staëlienne comme « une école d’indépendance » (182), qui désamorce la puissance de l’autre et le danger du « suivisme » (199) politique pour retrouver, par l’introspection, le pouvoir de l’opposition.
Transcender le manque, y voir, outre un « symptôme psychologique », une « condition de la pensée » (24) et le germe de vérités transcendantes, tel est le défi de cette troisième partie. Mais comment Staël, exilée et affaiblie par la maladie, parvient-elle à « vivre le négatif comme un bénéfice » (35) ? Sous la plume de S. Genand, l’auteur, fidèle à son « for intérieur » (272) et à cette « étrangeté » (271) si douloureusement apprivoisée, opposerait au syndrome de l’exil une force de sublimation. La solitude des forêts explicite le tournant 1807-1810 et la mise en scène du livre brûlé, De l’Allemagne. Faisant de la dissidence, plus qu’un « devoir » (274), une revendication filiale héritée de Necker, S. Genand remet en cause la « stratégie de profil bas » (279) qui accompagne l’exil, soutenant plutôt l’hypothèse d’une identification de Staël à l’« audace transgressive » (285) d’un Napoléon lui-même réexaminé à la lumière de sa déroute dans les Considérations. L’écriture ainsi « sublimée par la proscription » (289), trouve alors une légitimité nouvelle : cette période n’offre-t-elle pas la « révélation métaphysique » (301) des lectures germanistes et l’avènement d’un « exercice de la pensée pure » (302) inspiré par Kant ? Chapitre parallèle, La force comique dévoile l’exil sous un autre jour : on y découvre une Staël, qui, pour être exilée, n’en est pas moins capable de dérision et surtout d’un « élan dialectique » (334) qui caractérise ses dernières pièces et leur « écriture adressée » (322), tournée vers l’avenir. Désamorcer la douleur, l’inverser en humour et l’esthétiser pour la scène théâtrale offrirait donc de nouveaux remparts face à la morosité, lorsque « l’art de se mettre à distance » (340) convertit l’ennui en « illusion du changement » (330). Sublimations saisit ainsi comment l’humour et la provocation permettent peu à peu de « désarmer l’angoisse » (346). En renouant in extremis avec le plaisir de la performance et le jaillissement originel de « paroles en l’air » (339), Staël retrouve les qualités premières d’une Louise volubile rencontrée au seuil de l’ouvrage, qui aurait en plus appris cette « distance heureuse à soi-même » (333) qu’elle applique in fine.
Ainsi s’achève La Chambre noire et avec elle le cycle des travaux staëliens auxquels S. Genand se consacrait depuis 2012 et que les deux derniers tomes de la Correspondance Générale et la publication des Œuvres de Rocca viendront compléter cet été. En partie inspiré par ces lettres inédites et les révélations qu’elles contiennent, l’essai aura permis d’éclairer cette vie encore partiellement inconnue en déroulant une évolution. Mais cette évolution supposée – reconstituée en trois parties qui s’anticipent chacune – ne reflète-t-elle pas surtout le parcours initiatique de l’herméneute ? Et ne devient-il pas, ainsi, un parcours didactique précisément destiné aux futurs lecteurs de G. de Staël ? Y ressurgissent d’ailleurs les thèmes des premiers articles de S. Genand : rhétorique des passions, littérature « investie » et identité, douleur de la séparation, vies traversées, dépaysement ou encore pensée « négative » du despotisme, autant de concepts qui aboutissent à même proposition : rencontrer l’être dans l’œuvre et l’éclairer à partir de ce que sa voix aura fait résonner en nous. Si S. Genand referme derrière elle la porte de sa chambre noire, elle ouvre, en sortant, une fenêtre pour les futurs chercheurs, présentant dans un épilogue ses travaux comme une « première étape de relecture » (349) dont elle encourage la poursuite. Aujourd’hui précurseur de cette pensée du négatif, La Chambre noire, au-delà de sa nouveauté théorique, propose une refonte idiomatique stimulante. L’œuvre staëlienne aura donc trouvé en S. Genand une interprète qui, à force de s’intéresser à l’envers de l’œuvre et d’emprunter ses chemins détournés, parvient à verbaliser jusqu’à ses impasses et répond à ses échos, redonnant leur juste place aux paroles laissées en suspens.