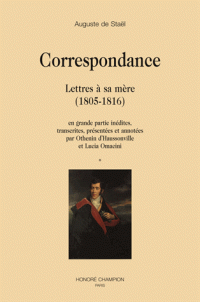La présente publication constitue un exemple réjouissant en fait de récidive éditoriale : suite à la parution du septième tome de la Correspondance Générale de Germaine de Staël en 2008, et après avoir recueilli des lettres en partie inédites adressées à son fils, le comte Othenin d’Haussonville, assisté de Lucia Omacini, nous a livré 737 pages d’un dialogue épistolaire déployé sur plus de onze années. L’échange, divisé en vingt périodes qui sont autant d’époques de séparation entre la mère et le fils, présente 433 lettres, parmi lesquelles figurent 72 lettres de Mme de Staël et 355 d’Auguste, ainsi que 6 lettres diverses. Les Lettres à sa mère constituent donc l’un des rares exemples d’ouvrages réunissant la correspondance à la fois active et passive de G. de Staël et s’imposent comme une réelle source d’informations pour les années post-1812, dont Auguste est l’un des seuls « conteur[s] » (256) et dont les récits sont d’autant plus précieux qu’il contribue à la fuite de Coppet où il demeure pour confondre les autorités.
Sans doute fortifié par le travail préparatoire de la comtesse Le Marois et de Béatrice W. Jasinski auxquelles il rend hommage, Othenin d’Haussonville a su s’affronter de nouveau aux difficultés d’une telle entreprise. Le lecteur contemporain saura apprécier les différents outils scientifiques mis à sa disposition, des explications génétiques à la notice des personnages qui occupe 144 pages. L’attention portée à la restitution des mots biffés et toutes autres corrections dans le corps du texte, ainsi que l’analyse scrupuleuse des lacunes de certaines lettres participent de la qualité de l’ouvrage et en font une édition au service de la recherche, qui assume ses indéterminations et nous invite à résoudre les énigmes qu’elle présente, à commencer par celle des lettres manquantes. Ces lettres sont systématiquement indiquées en note dans le premier tome ; l’éditeur évoque alors souvent les archives de Broglie où il les soupçonne de se trouver. Mais à trop se laisser entrainer sur la piste de ces lettres, on constate certaines maladresses : ainsi, lorsque G. de Staël fait référence à un courrier de son fils dans sa lettre 135, il suffit de revenir trois pages en arrière pour trouver dans la lettre 131 le contenu correspondant point pour point au contenu attendu dans cette lettre dite manquante.
En ce qui concerne l’organisation du corpus, l’éditeur explique avoir bénéficié d’une classification antérieure des lettres, établie par Auguste, au moyen d’un chiffre et d’une lettre attribués à chaque courrier. On reconnaît ici l’application du futur éditeur des œuvres complètes de sa mère et de son grand-père, qui se signale déjà lorsqu’il exhorte sa mère à copier les dates d’envois et de réceptions de leurs courriers. Il subsiste des extraits de ses propres comptes, pour les années 1807, 1808 et 1809, présentés au début des périodes concernées. Sous forme de listes, ces précieux documents nous informent de la fréquence des échanges : alors que le premier extrait est incomplet et mentionne trois lettres auxquelles nous avons accès, les deux autres listes dévoilent l’étendue des lettres perdues, et nous apprennent leur contenu en quelques mots. L’ironie du sort veut que sans le savoir, Auguste facilitât par ce travail une publication à laquelle il s’était tant opposé de son vivant, notamment dans la préface des Œuvres Complètes de Madame la baronne de Staël. Intermédiaire curieux que l’on peut surprendre à lire les courriers de l’empereur de Russie adressés à sa mère, Auguste était sûrement le mieux placé pour percevoir l’intérêt de ces échanges. Mais son séjour d’août 1809 à Paris, qu’il doit à la rumeur qui s’est répandue d’une publication à venir des lettres de sa mère à M. de Guibert, lui aura sans doute appris son impuissance face à une telle situation et la nécessité de s’en préserver par l’anathème que l’on connaît. Remarquons pourtant l’attention systématique que G. de Staël porte à la conservation des lettres de son fils, qui, au- delà du simple automatisme, manifeste leur caractère sacré et toute la considération qu’elle leur accorde, participant ainsi à la remise en question sinon de leur publication, au moins de leur destruction sacrilège.
En rejoignant la longue série des textes intimes qui jalonnent la bibliographie des membres de la singulière famille, ces lettres interrogent le concept de filiation : G. de Staël y assume un rôle de gouverneur de conscience qui renoue avec le spectateur intérieur de Suzanne Necker pour ce qui est de l’analyse psychologique. On ne saurait d’ailleurs ignorer la spécularité des lettres de « Minette » adressées à S. Necker et celles de « Minou » (80) qui révèlent le même désarroi face à l’objet épistolaire :
Je ne sais pas ce qu’ont les miennes [de lettres], mais quand je les relis,
je trouve comme toi qu’elles n’expriment rien de tout ce que je ressens. (40)
Mais alors que S. Necker tâchait d’inspirer plus de brièveté au style trop monté de sa fille, G. de Staël exige des lettres de quatre pages à chaque courrier (42) et encourage l’abandon. Dans la première série de lettres, les leçons maternelles se multiplient pour enseigner au « patologue » (7) le « besoin de [s]e communiquer » (71). Cette attention portée au perfectionnement de l’« intime communication de cœurs » (34) qui traverse la Correspondance Générale, ressurgit dans les lettres d’Auguste. Comment donc faire entendre ce qui se trouve « au fond du cœur » (101) à travers une forme conçue pour les « demi- confidences » (199) ? Auguste trouve des ressources inattendues : s’il écrit « sans se soucier de son style » (XIX) comme l’affirme l’éditeur, ses lettres manifestent un sens de la formule sans doute emprunté à sa mère. Sous sa plume, on devine l’influence de l’« atmosphère poétique » (92) qui entoure Mme de Staël, comme le suggère cette réplique inspirée de Corinne : « J’ai le manteau de plomb de l’enfer de Dante » (275) que l’on retrouve d’ailleurs dans les Lettres inédites à Louis de Narbonne. Auguste se forge un personnage romantique agité par le « heimveh » (87) (entendons le mal du pays) qui justifie l’émergence de digressions méditatives aboutissant au même « refrain » (376) : la volonté de se réunir.
De ces leçons, Auguste retient aussi la nécessité d’une utilité de l’échange épistolaire qui se concrétise en un devoir d’action, souvent malaisé : Auguste devient l’interprète confus des volontés maternelles parfois contradictoires (23), qu’il peine à réaliser tant la distance rend son dévouement précaire. Ses lettres sont donc le lieu de passage d’informations capitales : non seulement Auguste traite des affaires de sa mère, et notamment de la liquidation des deux millions, mais aussi de ses amours, la cinquième période étant par exemple consacrée aux négociations avec Benjamin Constant afin que le mariage de ce dernier avec Charlotte de Hardenberg ne soit pas publié. On est alors saisi par l’esprit d’entreprise de sa mère qu’il considère comme la « meilleure tête d’affaire » (732) qui soit et dont il s’inspire dans ses calculs et ses conjectures. Ses lettres sont considérablement documentées et souvent assorties de livres pour G. de Staël et ses proches, de comptes des dépenses, de notes ou d’arguments listés pour ou contre la prise de décisions. Les grands évènements comme les deux rencontres avec Napoléon ou celle avec l’impératrice Joséphine font l’objet de consciencieux récits où les dialogues sont retranscrits de mémoire. On retrouve ainsi dans les lettres d’Auguste le goût de sa mère pour les curiosités du langage et son plaisir à étudier les manies de caractère : Auguste lui rapporte les « on-dit » (718) et développe un sens efficace de l’anecdote. Il trace encore des portraits spontanés et parfois cyniques de ses rencontres, dénonçant les ridicules voire les infidélités de leurs proches : Mathieu de Montmonrency et Benjamin Constant, sur lesquels il ne tarie pas d’éloges durant ses premiers séjours à Paris, sont méconnaissables dans le second tome.
Si l’éditeur nous présente Auguste comme l’« un des membres du Groupe de Coppet » (I) et renouvelle ainsi l’image traditionnelle de cet homme souvent confondu avec les grandes figures féminines de sa vie, de Mme Récamier à Mme de Saint-Aulaire, il semble qu’Auguste doive conquérir au prix de sa volonté propre une place dans cette société. Son discours trace un autoportrait précaire et souvent douloureux : il ne sait pas quel rôle jouer de l’« ami », de l’« oncle » ou du « vieux protecteur » (257) de sa mère, ni qui devenir, du « baron » (397) ou du « notaire » (623). La lettre 252 dans laquelle éclate une colère inédite résume à elle seule le désœuvrement de sa situation d’émissaire ; Auguste y examine la question de son droit au bonheur. Le dialogue épistolaire qui se meut en un monologue du fils, par l’amenuisement progressif des lettres de Mme de Staël, laisse entendre la voix du véritable l’« exilé » (444). Dès lors, la lettre, ou plutôt le caractère intermédiaire de toute communication épistolaire, symbolise l’entre-deux dans lequel se trouve Auguste, lorsqu’il doit par ce recours, jugé « imparfait » (272), convaincre sa mère qu’il n’est pas le « songe-creux » (664), mais plutôt l’« enfant prodige » (413) qu’elle perçoit en lui et s’imposer ainsi en héritier légitime de Jacques Necker. Auguste supporte donc mal les reproches d’« étourderie » (731) de sa mère qui s’offusque de leurs divisions trop évidentes lorsqu’Auguste s’exprime sur l’« indignité » (216) du divorce, ou raisonne sur l’écart qui doit séparer l’homme de la femme écrivain (352). Si ses lettres suggèrent une succession d’ambitions personnelles – sa vive inclination pour les mathématiques, le mirage de l’école Polytechnique, l’éventualité d’un « service militaire » (450), ou l’attrait pour les missions diplomatiques –, l’homme se dissimule encore derrière la figure maternelle. Il reste donc à découvrir l’âge adulte qui ne commencera véritablement qu’après la mort de G. de Staël et la prise de conscience de l’œuvre qu’il reste à écrire, comme le montre la biographie liminaire par laquelle l’éditeur réhabilite ses différents travaux.
Aussi, cette correspondance retiendra-t-elle l’attention des lecteurs curieux de découvrir les « lettres d’amour du fils à sa mère » (XIX) qui perpétuent ainsi la tradition familiale de la filiation passionnelle comme le tout premier lien social. La parution prochaine des deux derniers tomes de la Correspondance Générale, qui contiendront leur lot de révélations, ne saurait donc priver ces lettres de leur intérêt poétique qui entre en résonance avec l’ensemble du réseau épistolaire staëlien dans lequel elles trouvent, grâce à O. d’Haussonville, toute leur place.