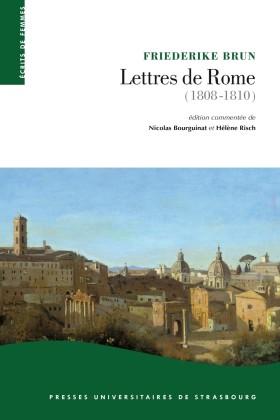Auteur de poèmes et de textes viatiques et autobiographiques, la Danoise Friederike Brun (1765-1835) semble aujourd’hui bien méconnue. D’expression (et de naissance) allemande mais parfaitement polyglotte, cette figure cosmopolite était pourtant une intime de Germaine de Staël et de Charles-Victor de Bonstetten, familière des cercles d’Iéna et de Weimar. C’est donc à une entreprise de réhabilitation que se livrent ici les deux éditeurs, afin de mettre en lumière l’apport intellectuel d’une grande Européenne. Les lettres romaines sont pour la première fois traduites en français par Hélène Risch, assorties d’un solide appareil critique comprenant un copieux et éclairant « Commentaire » final signé par l’historien Nicolas Bourguinat. Ce dernier est également le directeur de la collection interdisciplinaire « Écrits de femmes » aux Presses universitaires de Strasbourg, qui depuis 2014 se propose de faire entendre des voix oubliées ou ignorées à un public élargi – et dont ce volume constitue le deuxième titre paru.
Les cinq lettres de F. Brun sont adressées à son frère, Friedrich Münter, théologien et antiquaire ayant lui-même longuement fréquenté les cercles savants de la Ville éternelle. Elles composent, à quelques interruptions près, une chronique de son séjour romain, de février 1808 à juin 1810 ; révisées et réagencées, elles connaissent une première publication à Dresde en 1816.
Les travaux de Marie-Claire Hoock-Demarle ont bien montré l’importance du commerce épistolaire dans l’espace germanophone du tournant des Lumières. Journal par lettres empruntant à divers genres littéraires, le texte de F. Brun est d’abord un objet hybride. Il s’inscrit, bien entendu, dans la tradition du récit de voyage en Italie bien qu’il ne constitue ni un tableau général de Rome, ni un guide à l’usage des pèlerins ; une telle publication de femme auteur est d’ailleurs exceptionnelle, dans le champ de la littérature viatique du premier xixe siècle. À l’époque de la rédaction, le roman Corinne ou l’Italie (1807) de G. de Staël est dans tous les esprits et ne peut qu’apparaître en filigrane des pages de F. Brun : l’on sait que les deux femmes se sont connues à Coppet en 1801, et qu’elles ont par la suite noué des liens étroits.
F. Brun a d’abord voyagé dans la péninsule en 1793-1796 (pour des raisons de santé) puis en 1802-1803, en compagnie de Bonstetten. Elle est ici établie, avec sa fille Ida, piazza Colonna, le long du Corso, dans le quartier des artistes étrangers. Rome se trouvait en effet, depuis la seconde moitié du xviiie siècle, au cœur d’un réseau néoclassique international. Lors de son premier séjour, l’auteur a fréquenté la petite colonie des portraitistes et védutistes – Hackert, Koch ou Angelika Kauffmann. L’ambassadeur prussien Wilhelm von Humboldt et son épouse Caroline étaient installés à la Villa Malta depuis 1802, accueillant de nombreux artistes allemands et danois (ainsi que F. Brun, qui y résida en 1802-1803). Le nom de Bertel Thorvaldsen apparaît bien sûr dans les lettres : le célèbre sculpteur danois, que l’épistolière surnomme « Phidias-Thorvaldsen » (p. 69), s’était fixé à Rome dès 1797. Grande admiratrice de son talent, F. Brun le soutenait par des opérations de mécénat – et Thorvaldsen réalise en 1809 le buste d’Ida Brun, exposé au Capitole. Elle déclare également fréquenter le poète milanais Alessandro Verri, apprécié de G. de Staël pour ses Nuits romaines au tombeau des Scipions (1792); le vieil antiquaire Séroux d’Agincourt, érudit renommé mort en 1814 et à qui elle rend hommage dans la troisième lettre ; ou encore le peintre espagnol néoclassique José de Madrazo y Agudo.
Si les lettres accordent très peu de place aux descriptions d’œuvres d’art et de paysages, les idéaux esthétiques de l’auteur transparaissent ponctuellement : « C’est seulement à Rome que cette beauté classique (que Raphaël a saisie ici, d’après nature, pour toutes ses figures féminines) […] est si généralement répandue » (p. 43). L’on note encore une sensibilité picturale de l’épistolière, attentive aux jeux d’ombres et de lumières ou aux beautés (tant vantées par Chateaubriand) de la campagne romaine, « ravissant paysage classique » aux « pittoresques ruines » propices à la rêverie (p. 81). Mais le pouvoir de suggestion des vestiges du passé, mis en avant par Bonstetten – dans son Voyage sur la scène des six derniers livres de l’Énéide (1804) – ou Staël, n’est manifestement pas ici l’objet de la réflexion.
Fille de pasteur, l’auteur écrit à l’attention de son frère devenu en 1808 évêque de Seeland. Il est donc naturel que les questions religieuses occupent le premier plan, et les lettres sont, de fait, centrées sur la Rome pontificale plutôt que sur la Rome antique ou les beaux-arts – le titre initial l’annonçait d’emblée (« sur la persécution, la captivité et la déportation du pape Pie VII »). De manière assez surprenante de la part d’une luthérienne convaincue, un émouvant portrait y est brossé du souverain pontife, « vieillard sans défense » à l’égard duquel l’auteur fait preuve d’une réelle empathie et qu’elle qualifie de « héros » tout au long du journal – sa conduite exemplaire lui inspire d’ailleurs deux poèmes particulièrement lyriques, insérés dans la troisième lettre. F. Brun, sensible aux fastes de l’Église contrairement aux autres voyageurs protestants, semble même militer pour un œcuménisme épanoui : « si donc un jour […] tous les confesseurs du christianisme se rassemblaient, […] réunis par le sentiment de la haute unité de la confession chrétienne : […] quel point de la Terre serait alors plus digne de recevoir les vœux communs de tout le monde chrétien que la magnifique cathédrale de Saint-Pierre ! » (p. 82-83). De son point de vue, en effet, le pape ne lutte pas que pour les fidèles catholiques, mais bien pour « la liberté religieuse de toutes les confessions chrétiennes » (p. 75).
La dimension historique et politique de ce journal romain en représente sans doute l’intérêt majeur. F. Brun livre, à travers l’éloge de Pie VII et de sa digne résistance morale, ce qu’elle nomme une « martyrologie politique » (p. 53) doublée d’un réquisitoire antinapoléonien. Il faut néanmoins rappeler que ses lettres ne furent publiées qu’après la chute de l’Empire, ce qui rend son opposition certes moins téméraire que celle de G. de Staël. Les troupes françaises, sous les ordres du comte Miollis devenu gouverneur général, occupaient la ville sainte depuis début février 1808, dans l’hostilité croissante de la population et du clergé. L’épistolière scandalisée n’a de cesse de dénoncer les agissements du « tyran » Napoléon, nouvel Attila à l’« âme sombre de barbare » (p. 29) dont elle contribue à élaborer la légende noire. Depuis la signature du Concordat et le sacre de 1804, les relations avec la papauté s’étaient progressivement envenimées ; l’affrontement et les sacrilèges commis occupent la chronique, élevée au rang de pamphlet : « Je poursuis, au jour le jour, l’histoire honteuse de la tyrannie française » (p. 44) – en passant par l’annexion des États pontificaux, l’excommunication de Napoléon puis l’arrestation du pape en juillet 1809 et sa déportation. Il faut noter le soin avec lequel F. Brun mène l’enquête, soucieuse de rapporter des faits avérés et non de simples rumeurs : son texte revendique le statut de document et relève même, pour elle, de l’impératif moral. La violente critique du despotisme ici déployée s’accompagne d’une compassion certaine à l’égard de Lucien Bonaparte, brimé puis banni par son frère à cause de son union avec Alexandrine de Bleschamp et dont les souffrances rachètent, aux yeux de l’épistolière, son rôle lors du 18 brumaire ; l’esprit de résistance et d’indépendance de Lucien est perpétué par sa courageuse fille aînée, Charlotte, qui refuse tous les partis présentés par Napoléon. Un tel bras de fer entre liberté individuelle et oppression d’État n’est évidemment pas sans évoquer la situation de G. de Staël, dont l’errance forcée à travers l’Europe préoccupera beaucoup son amie. À l’infamie de l’invasion s’ajoute celle de l’impiété des Français, ces « fils de la Révolution » (p. 38) encore qualifiés de « barbares infidèles » (p. 98). Miollis lui-même, homme honnête et modéré, bénéficie toutefois de l’indulgence de F. Brun : « on ne peut pas le regarder sans regretter qu’il serve ce maître-là […]. On dit qu’il a accepté le poste uniquement parce qu’il aime vraiment beaucoup l’Italie et Rome en particulier, et qu’il voulait empêcher que les choses prennent une tournure plus grave. » (p. 47-48). Le récit inclut force détails, dont l’épisode du carnaval de 1809 : ce morceau de bravoure des récits de voyage en Italie, depuis celui de Goethe, acquiert ici une valeur politique et symbolique puisque l’événement a fait l’objet d’un conflit entre le pape et les Français, résolus à maintenir à tout prix les festivités. Boudé, il devient l’emblème de la « vraie grandeur d’âme » des Romains (p. 60) alliés à Pie VII pour défendre pacifiquement « la liberté de conscience de toutes les nations d’Europe » (p. 65) menacées par un pouvoir arbitraire. L’idée d’un peuple devenu le dépositaire de toutes les valeurs et dont il dépend de faire revivre la gloire nationale désormais asservie et en sommeil s’exprimait déjà dans les carnets de voyage italiens de G. de Staël, puis dans Corinne.
F. Brun consacre enfin une partie de sa dernière lettre (p. 103-105) à la dénonciation des pillages ou de l’exil des œuvres d’art et des antiques des grandes collections romaines – Ruspoli, Cerevetra, Giustiniani ou Borghèse – ainsi que des archives pontificales, ce qui atteste un véritable souci patrimonial de sa part. Le texte s’achève cependant sur une note d’espoir, avec l’évasion de Lucien Bonaparte : « On a des raisons de croire que l’Angleterre n’est que sa prochaine étape, et qu’ils iront chercher dans une autre partie du monde [l’Amérique rêvée] la paix et la liberté, qui paraît fuir toujours plus loin notre malheureuse Europe. » (p. 109). En 1816, auteur et lecteurs savent que le sursaut des peuples a eu lieu, et que le souverain pontife a bel et bien regagné son palais du Quirinal.
Cette utile édition des lettres de F. Brun offre ainsi un regard original de « femme du Nord » sur la Rome des années 1800, située dans le prolongement du « triste cycle de la Révolution » (p. 104) – l’on sent l’épistolière encore très marquée par la violence et les exactions de la Terreur. Oscillant en permanence entre la consternation et l’indignation, l’auteur prend à témoin l’opinion européenne et défend la primauté des valeurs spirituelles universelles triomphant in fine de la force. « Dans la lignée des réflexions de Benjamin Constant, elle a sans doute cherché à reformuler une problématique nouvelle des rapports entre religion et liberté », conclut N. Bourguinat (p. 147). Au-delà de son destinataire direct, un tel « reportage » sur des faits contemporains interroge les méthodes scientifiques du passé comme du présent : « Je te donne, à partir des nouvelles qui ont retenti ici, comme Goethe le fait à partir de sa vie, Wahrheit und Dichtung, vérité et poésie. Tu les soupèseras et les distingueras plus tard, avec le sens de la critique historique qui vous est inné, à vous autres chercheurs. » (p. 90).